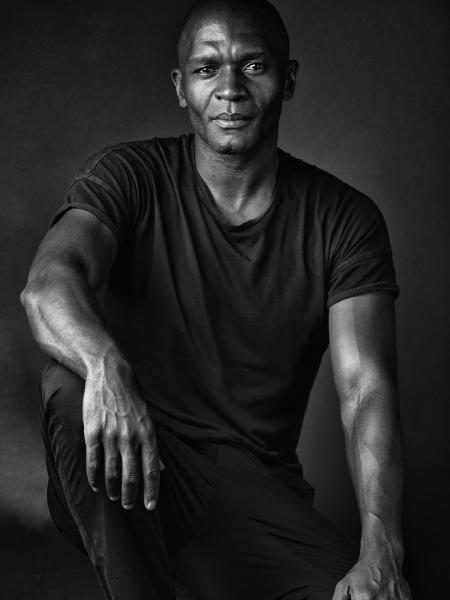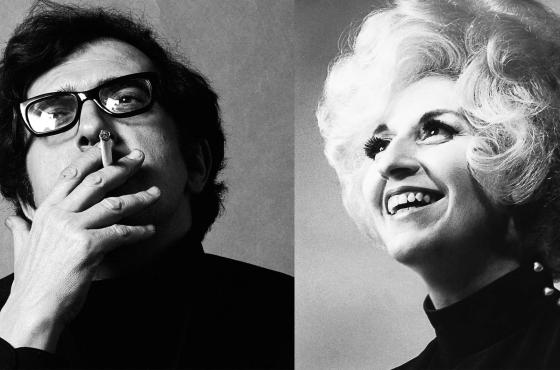« Un mar de músicas » combine des musiques anciennes d’Afrique, d’Amérique et des îles caraïbes, des musiques relativement peu connues en Europe. Qu’est-ce qui vous a incité à créer ce programme ?
Jordi Savall : Tout d’abord, j’ai effectué des recherches approfondies sur la présence espagnole en Amérique du Sud et sur les influences musicales qui y sont associées. J’ai découvert que de nombreux compositeurs, en particulier au début du XVIIe siècle, s’étaient inspirés de la musique et des langues traditionnelles des esclaves et des peuples indigènes. Il s’agit des « Villancicos de Lenguas » ou « Villancicos Criollos ». Les paroles sont principalement en espagnol, mais certains vers sont en langues africaines ou indigènes, ou du moins influencés par elles. J’ai également fait des recherches à la bibliothèque de Las Palmas de Gran Canaria. C’est dans ce port que de nombreux navires ayant à leur bord des esclaves et des marins attendaient que le temps soit suffisamment clément pour mettre le cap sur l’Amérique. Parfois, ils devaient attendre un mois, voire plus, jusqu’à ce que les conditions météorologiques permettent un aussi long voyage. Il y a aussi les « Villancicos de Lenguas » avec des vers en arabe, en italien et en polonais - dans de nombreuses langues différentes, parfois inattendues. Les marins provenaient de différents pays et emportaient souvent une guitare en prévision du long voyage, ou bien ils chantaient et dansaient. Ils avaient besoin de musique - et c’était à eux de la faire !

Le concert se compose principalement de musique qui n’a été transmise qu’oralement. Comment en êtes-vous venu à cette musique et qu’a déclenché en vous ce voyage à travers l’histoire ?
Jordi Savall : J’ai commencé à lire beaucoup de livres sur le passé esclavagiste. Chaque année, des millions de personnes étaient enlevées en Afrique et emmenées aux îles Canaries ou ailleurs ; là, elles étaient retenues en captivité jusqu’à ce qu’un navire ou un passeur les emmène. Pour ceux qui participaient activement à ce système et en profitaient, la vie des personnes réduites en esclavage n’avait aucune valeur. J’ai été profondément touché par cette inhumanité et les nombreux récits tragiques continuent de m’émouvoir. J’ai compris que je devais aborder cette histoire par le biais de la musique. Lorsque j’ai commencé mes recherches, j’ai réalisé qu’une grande partie de la magnifique musique d’Amérique - la musique que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Negro Spirituals, ainsi que la musique de l’ensemble des Caraïbes et de la Colombie, du Brésil et du Mexique - est fortement influencée par les traditions africaines.
Le concert met principalement l’accent sur les influences africaines présentes dans la musique cubaine. Ces œuvres sont issues de religions très anciennes qui existent encore aujourd’hui. J’ai commencé à travailler avec des jeunes qui maintiennent ces traditions vivantes. C’est alors que j’ai eu l'idée de créer un programme de concert d’œuvres historiques chantées vers 1550-1600. Nous commençons par la musique du début du XVIe siècle, puis nous continuons chronologiquement au fil de l’histoire. En l’associant à d’anciennes musiques traditionnelles de pays africains - Madagascar et le Mali - et d’Amérique du Sud - la Colombie, le Brésil et le Mexique -, nous avons pu composer un programme magnifique.
Les textes récités constituent l’autre aspect important de ce programme. D’où viennent-ils ?
Jordi Savall : Je cherchais des sources écrites racontant les événements de l’époque. Le premier document détaillé décrivant le fonctionnement de la traite des esclaves date de 1455. Des soldats portugais sont entrés dans un village et ont emmené tous les jeunes adultes. Ils ont tué tous les enfants et les vieillards, puis ont embarqué les hommes et les femmes jeunes et en bonne santé sur un bateau. Arrivés en Algarve, ils ont été séparés. Les frères ont été séparés les uns des autres, les femmes des hommes etc. Sur son cheval, le roi Alfonso V a finalement choisi certains des esclaves pour le couple royal. Cette description documente pour la première fois cette barbarie inhumaine. L’esclavage a toujours existé. La civilisation grecque n’aurait pas pu fonctionner sans une classe inférieure, sans des gens qui ne faisaient que travailler. L’histoire de la lutte pour la survie contre l’esclavage est très poignante. La musique a joué un rôle important.
Qu’est-ce que la musique nous apprend sur ces personnes réduites en esclavage ?
Jordi Savall : Il faut s’imaginer que ces personnes n’avaient rien, et surtout pas de droits. Mais elles savaient chanter et danser. C’était la seule liberté dont elles disposaient. En chantant la musique de leur culture, elles se sentaient liées à leur histoire et à leur existence. Elles racontaient de vieilles légendes et de belles histoires. Avant tout, il ne s’agissait pas de chansons de protestation, car la protestation n’était pas encore une option. Ce sont des chansons qui les reliaient à leur culture, à leur patrie. Et l’évolution des récits montre clairement que la mer a été très tôt une grande source d’angoisse, car elle représentait la porte vers un monde inconnu, où la liberté était absente. Dans d’autres récits, la mer prend une nouvelle signification : lorsque les gens sont déjà arrivés dans le Nouveau Monde et qu’ils voient la mer comme un chemin vers la liberté. Le titre du concert d’aujourd’hui, « Une mer de musique », fait référence aux nombreuses traditions musicales conservées jusqu’à nos jours et dans lesquelles la mer joue un rôle majeur.
Vous avez déjà mentionné que l’on entend de la musique traditionnelle de cultures africaines à Cuba et au Brésil, par exemple. La musique religieuse a également une influence majeure, en particulier celle de la religion yoruba. Au fil des siècles, cette religion s’est mêlée aux traditions chrétiennes en Amérique du Sud, donnant ainsi naissance à une diversité d’expressions culturelles. Qu’évoque la musique religieuse de l’époque de l’esclavage ?
Jordi Savall : Les différentes religions ont aidé les gens à garder espoir - la dimension spirituelle de leur existence leur a donné de la force. Les traditions yorubas ont encore une très forte influence de nos jours. La musique est très puissante, comme nous l’entendrons lors de ce concert, soulignée par les gros tambours. Chaque style de musique a un rythme très particulier. C’est une musique incroyable, magnifique, archaïque, tellement intense et émouvante.
Outre les instruments européens anciens, vous utilisez donc également des instruments issus d’autres cultures ?
Jordi Savall : Oui, chaque groupe apporte des instruments différents. La kora, par exemple, est originaire du Mali. Il s’agit d’une harpe d’Afrique de l'Ouest, un instrument fantastique. Les musiciens du Mexique et de Colombie jouent sur des guitares de cette époque révolue. Les Cubains et les Brésiliens apportent également leurs guitares et leurs tambours. C’est une fantastique mosaïque de cultures différentes.
Quelle musique d’Haïti présenterez-vous ?
Jordi Savall : Nous travaillons avec une chanteuse haïtienne, Sylvie Henry, qui a une voix extraordinaire. Elle chante de magnifiques chants traditionnels de l’époque. Il y a un certain contraste dans la musique, qui dégage souvent charme et douceur, avant de se transformer en complainte, puis d’enfin respirer la joie - ces gens compensaient leurs nombreux problèmes en chantant. Plus ils souffraient, plus le chant devait être optimiste. C’est cette énergie qui les a sauvés et leur a donné force et espoir.
D’Haïti et de Cuba, nous traversons la mer vers le continent avec la musique de Gaspar Fernandes du Mexique. Les paroles de ses chansons sont en partie écrites en nahuatl, une langue ancienne parlée par les Aztèques et d’autres peuples nahuas d’Amérique centrale et qui reste aujourd’hui la langue maternelle d’une partie de la population indigène du Mexique.
Jordi Savall : Au Mexique, il était courant de préserver les langues indigènes, ce qui a donné lieu à un merveilleux mélange de styles musicaux. Cela me fait penser à Elias Canetti. En 1942, il écrit dans The Human Province que la véritable histoire de l’humanité est la musique. La musique s’adresse à nos émotions, à nos cœurs. Lorsque nous écoutons cette musique ancienne, elle évoque en nous les mêmes sentiments que chez les gens d’alors. Et je l’affirme : sans la musique, l’histoire ne serait qu’un vaste désert. La musique donne vie à l’histoire et les émotions nous permettent dans une certaine mesure de nous identifier à elle.
Comment la musique des personnes réduites en esclavage et des peuples indigènes a-t-elle influencé la musique européenne ?
Jordi Savall : Prenons l’exemple de la chaconne. Aujourd’hui, nous connaissons de fantastiques chaconnes de Bach, de Rameau et d’autres grands compositeurs. Mais vers 1590, Lope de Vega parle de la « chacona ». Il affirme que la chacona provient des peuples indigènes et noirs du « Nouveau Monde ». Imaginez un peu : Un marin chante une chanson et les Noirs d’Amérique l’imitent. Ils créent une nouvelle musique, qui traverse la mer et devient une chacona très populaire connue sous le nom de A La Vida Bona de Juan Arañés, publiée à Rome vers 1608. Il s’agit de la première chaconne. La musique est très vivante, alors que plus tard, comme toutes les danses du XVIIe siècle, la chaconne devient plus pesante. Logique, puisque ces danses viennent des villages et atteignent la cour : on y porte des perruques et de grandes robes, et tout devient plus lourd et plus lent.
Vous avez créé ce programme avec des musiciens issus de traditions très différentes. Dans quelle mesure apprenez-vous les uns des autres au cours du processus de travail ?
Jordi Savall : J’ai énormément de respect pour tous ces musiciens. La musique n’est pas une chose qu’ils ont apprise dans un conservatoire comme s’il s’agissait d’une langue étrangère - elle fait partie intégrante de leur langue maternelle. Même en Bulgarie, en Turquie et en Grèce, par exemple, où la musique est issue de traditions anciennes, les gens apprennent la musique comme on apprend à parler. Elle est ancrée en eux. Lorsque vous faites de la musique basée sur l’improvisation, c’est incroyablement enrichissant. Cela crée une atmosphère incroyable, une créativité avec une certaine authenticité. Il s’agit d’un contraste avec notre système de notation musicale.
Qu’est-ce que ce concert peut déclencher chez le public - sur le plan mental et émotionnel ?
Jordi Savall : J’espère que le public pourra développer plus d’empathie envers ce moment sombre de notre histoire. Je crois que la bienveillance d’une civilisation réside dans sa capacité à réfléchir sur son histoire. Si nous ne connaissons pas suffisamment notre histoire, nous ne pouvons pas créer un bon avenir. Et je crois que le fait d’entrer en contact avec cette musique vibrante issue de différentes cultures et d’entendre les mots qui nous racontent ce qui s’est passé peut faire la différence. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu’était la vie de ces personnes. De grands philosophes ont vécu à la même époque et ont généré de grandes idées spirituelles - mais en même temps, nous, les humains, restons des bêtes. Je voudrais que le public se rende compte que nous connaissons encore des problèmes similaires aujourd’hui. Tout cela reste malheureusement très actuel.
Cet entretien a été réalisé par Olivia Artner pour le Berliner Festspiele / Musikfest Berlin.